Je m’appelle Louise, j’ai 26 ans et je vis à Paris. Dans cette newsletter, une sorte d’essai à la fois intime et documenté, j’essaye de comprendre des choses sur moi et le monde qui nous entoure. Bonne lecture !!
Coucou tout le monde !
J’espère que vous avez passé de joyeuses fêtes !!
Comme je ne sais jamais quoi dire, je me permets de m’inspirer des jolis voeux que l’on m’a adressé hier et je vous souhaite à tous une très belle année, “pleine de lumière, de rires, de petits bonheurs et de grands accomplissements” !!
J’avais tout sauf envie de travailler ces dernières semaines. Le 26, j’ai beau être arrivée chez un copain déterminée à travailler pour tenir le rythme que je me suis fixée il y a un mois, je me suis doucement laisser happer par ce relâchement national qui n’a lieu qu’à cette période de l’année : les mails qui n’arrivent plus, les jours qu’on oublie, les feux de cheminée qui s’enchaînent et les apéros qui occupent le tiers de la journée… Et ça m’a fait du bien. Bref, tout ça pour vous expliquer pourquoi cette newsletter arrive avec quelques jours de retard !
Comme tous les ans, j’ai aimé la période de Noël et cette attente à la fois nerveuse et réjouie des semaines qui précédent les fêtes de fin d’année. Les guirlandes lumineuses sur les branches des arbres, les sapins qu’on aperçoit aux fenêtres des appartements éclairés, leur odeur boisée quand on passe devant les fleuristes, les playlists de Noël dans les cafés, la soirée Love Actually avec mes soeurs, le séjour un peu régressif chez mes parents, les bons repas, les cadeaux… J’ai beau être un peu sarcastique et préférer la lucidité et l’ironie à un émerveillement un peu naïf, rien n’y fait : la “féérie de Noël” continue à faire vibrer la grande fille de 26 ans que je suis, sûrement conditionnée par l’émerveillement ressenti plus jeune. La magie des vitrines des galeries Lafayette, l’hystérie à la découverte des “preuves” du passage du père Noël, le déballage joyeux et frénétique des cadeaux, ça marque !
Mais j’ai quand même un peu muri et dans ma famille, il n’y a pas encore de bambins ravis qui permettraient de vivre par procuration les fantasmes autour de Noël. Et derrière la magie, le folklore, la joie et la féérie, il y a la fatigue accumulée depuis septembre, le corps qui chope tous les virus, la charge mentale liée aux préparatifs et à l’achat des cadeaux, et enfin l’ambivalence propre aux retrouvailles en famille. Tout cela donne lieu, en ce qui me concerne, à un cocktail joyeux mais un peu explosif. Comme l’écrivait Marie Robert dans ce post :
Les fêtes de fin d’année sont une période étrange, elles catalysent toutes nos ambivalences. Pour certains, elles symbolisent une joie nostalgique, un marqueur du temps qui réjouit, mais qui s’enrobe parfois d’une mélancolie à venir. Pour d’autres, elles condensent les contraintes, les efforts, les frustrations, la fatigue, comme une sorte d’épreuve, un passage obligé qui ne satisfait personne, mais dont personne ne peut faire l’économie.
Comme le rappelle cet article de Philomag, Noël est la “synthèse de toutes les réjouissances” :
Au-delà du folklore familial, de la comédie infantile, de l’alibi religieux et du motif commercial, de quoi Noël est-il le nom ? Noël est progressivement devenu un étonnant condensé des traditions culturelles les plus variées. Des célébrations antiques du solstice d’hiver à notre société d’hyper-consommation, en passant bien sûr par la nativité des chrétiens, Noël est la synthèse de toutes les réjouissances, qu’elles soient païennes et religieuses, commerciales et familiales. Familiales surtout, puisque Noël est une fête de famille et, plus encore, une fête de la famille, autour d’un banquet qui réunit les boucles blondes et les cheveux gris, et qui offre également un prétexte aux immersions, parfois heureuses, souvent éprouvantes, dans des belles-familles dont on apprend les codes à cette occasion.
Je pourrais aborder le sujet de Noël de plusieurs façons, mais j’ai eu envie d’écrire sur ce que cette fête représente le plus pour moi : les retrouvailles en famille, et ce qu’elles ont d’à la fois joyeux et éprouvant (ceci dit, je précise que je ne parle que de mon expérience qui est celle d’une famille fonctionnelle et soudée).
Entre small talk et débats houleux
On a passé une première soirée chez mes parents avec mes soeurs, mes cousins, ma tante et mon oncle, ma grand-mère. Ainsi, le 22 décembre au soir, une atmosphère aussi joyeuse qu’électrique a précédé l’arrivée des invités. Chacun était à ses essayages et à l’emballage de ses derniers cadeaux. De temps en temps, on entendait les exclamations exaspérées de ma mère, qui subit encore la charge mentale de ces préparatifs - “bon, ba mon gâteau est raté !”, “c’est à qui ce pull ??”
Quand j’ai entendu une première sonnerie puis la voix de mon cousin, j’étais en train de me maquiller. J’ai pris mon temps dans cette salle de bain, histoire de savourer le calme avant la tempête. Et puis, il a fallu y aller et faire la bise à tout le monde, à la fois joyeuse et tendue par la perspective de ces 2-3 heures pendant lesquelles il faudrait s’adapter, faire bonne figure, sur-jouer un peu la joie d’être ensemble, participer à créer un moment harmonieux, faire en sorte que la fiction familiale tienne.
On a discuté pendant l’apéro et parfois, je me suis sentie “décrocher et flotter au-dessus du groupe”, comme décrit une femme interviewée dans le super épisode Les fêtes de fin d’année du podcast la Zone Grise de Mūsae, média sur la santé mentale. En effet, parce qu’on ne se voit pas tant que ça et qu’il y a peu de place pour des échanges sincères et personnels quand on se retrouve à 12 autour d’une table, les conversations restent souvent un peu superficielles, on reste dans un small talk parfois gênant. Christelle Tissot, fondatrice de Mūsae, commente :
Noël étant un évènement ritualisé qui arrive peu souvent, on se retrouve avec des proches qu’on a plus l’habitude de voir et dans des discussions un peu artificielles qui ne mettent pas tout le monde à l’aise. Ce sont des moments qu’on peut ressentir comme un peu désincarnés.
Il y a quelque chose d’un peu grotesque à Noël dans le contraste entre ces attentes fantasmées de bonheur, d’harmonie, de connexion et de réconciliation, et la réalité. Cette attente fébrile, cet espoir confus et la déception qui les guettent sont très bien décrits par Frédéric Manzini dans cet article de Philomag :
Noël repose en effet essentiellement sur une attente, si confuse soit-elle : un cadeau, de la reconnaissance, une marque d’amour, de la joie partagée, on ne sait pas exactement ce que l’on doit en attendre, mais on l’attend, fébrilement, impatiemment. Le risque est donc que Noël se révèle décevant – ce qu’il est toujours, d’abord et surtout pour ceux qui s’en étaient fait une si grande joie.
On a trinqué, bu du champagne avec les petits fours, du sauterne avec le fois gras. On a parlé de la coupe du monde. “Ils se sont comporté comme des connards les argentins !” - “c’est vraiment un truc de mauvais perdants de dire ça, je suis désolé !” Les propos tranchés sont partis, l’atmosphère s’est tendue. J’ai un peu retenu mon souffle et je me suis dit quelque chose comme “là, si ça part en vrille, on pourrait se fritter pendant 15 ans”.
On est passé à table et on s’est servi de chapon, de salade de choux, de purée de potiron, puis de gâteau au chocolat et de tartelettes au citron. J’ai attendu que tombent les sujets sensibles du type écologie et dérives du wokisme. Avec une innocente petite remarque - “c’est marrant quand même notre rapport à la religion, on est cathos une fois par an”, j’ai provoqué un petit speech sur l’importance des traditions et de notre culture chrétienne. Mais pour une fois, on a peu parlé de politique et on a bu et mangé dans la paix et la bonne humeur. D’habitude, les mêmes débats reviennent, avec les mêmes arguments, une distribution de la parole similaire et le cri du coeur annuel de ma grand-mère en réaction aux opinions politiques d’un de mes cousins : “Est-ce que tu te rends compte que Mélanchon était un grand admirateur de Robespierre ?! ”.
Les fêtes de fin d’année sont propices aux débats houleux et quelque part, cela montre aussi que nos croyances, nos opinions et nos valeurs sont confrontées à celles de personnes qui ne les partagent pas - parce qu’elles sont d’une autre génération, d’un autre “camp” politique, d’une autre bulle d’information. Mais voilà, peut-être parce qu’on est de moins en moins habitués à ces confrontations, certaines remarques peuvent nous hérisser le poil et les échanges devenir très conflictuels.
D’ailleurs, pendant les trois jours précédant le réveillon, mon feed Instagram et ma boîte mail ont été envahis par des tips divers et variés pour “survivre à Noël”. Sur la chaîne de Blast sortait la vidéo Comment survivre à un débat sur l’écologie pendant les fêtes ?, Binge Audio rediffusait un épisode nommé Guide survie aux fêtes de famille avec des conseils pour réagir aux propos sexistes, racistes et homophobes prononcés autour de la table de fête, My Little Paris publiait une newsletter avec l’objet “objectif : évasion familiale”, Le Filtre publiait un "kit de survie pour fêtes en famille” sur Instagram - “ramenez un +1 pour que votre famille se tienne à carreau”, “devenez pro dans l’art de changer de sujet”, “trouvez vos alliés”… Et dans sa newsletter Six tips for avoiding holiday burnout, la journaliste Heather Havrilesky donnait des conseils pour que ça se passe bien.
Entre injonctions et conseils non sollicités
Mais si je redoute ces retrouvailles en famille, c’est surtout parce qu’il s’agit d’un moment “état des lieux” qui nous confronte au regard de sa famille. Il y a trois semaines, une personne me souhaitait d’ailleurs de joyeuses fêtes et du “courage pour les repas familiaux dont les convives ont parfois du mal à comprendre nos choix "peu conventionnels" et ne se privent pas de nous rappeler le "droit chemin" du CDI, du mariage et de la résidence principale”.
Comme à chaque réunion de famille, j’ai attendu la question fatidique, parfois accompagnée d’une mine sceptique ou d’une once de pitié : “Et toi Louise, tu en es où ?”. Dans ces moments-là, j’ai l’impression d’être le personnage de Julie dans Julie en 12 chapitres, honteuse et bégayante lorsqu’elle doit expliquer à d’autres trentenaires bien établis ce qu’elle fait dans la vie. Pourtant, je trouve ma voie petit à petit et je pourrais parler d’écriture et de newsletters pendant des heures. Si je redoute encore cette question, c’est parce que ce que je fais n’a ni de rapport avec mon diplôme d’école de commerce, ni de nom - je ne suis ni journaliste, ni écrivaine - parce que je ressens un gros syndrome de l’imposteur et que je ne peux pas encore rassurer parents, oncles et cousins à coup de chiffres un peu “frime” sur mes revenus ou mon nombre d’abonnés. Tout ça en étant entourée, dans ma famille, de personnes qui ont des parcours cohérents et des métiers facilement identifiables.
Quand mon cousin architecte a parlé de son nouveau chantier de musée hyper stylé, ma mère s’est tournée vers moi et a dit très fort “Ah ba tiens Louise, tu pourrais écrire sur ça non ?”. Pour réponse, elle a récolté un regard noir et un “arrête c’est gênant”. Plus tard, dans la cuisine, elle m’a dit : “mais je vois bien, tu sais pas te vendre !!” Pendant le dîner, ma grand-mère a regardé mes cousins et a dit : “ils réussissent bien tous les deux !”, avant de désigner ma petite soeur : “Garance aussi, elle a une belle situation”. Honnêtement, ce n’est même pas un coup dur : elle a 86 ans, ne comprend pas très bien ce que je fais et je n’ai jamais pris le temps de lui expliquer. Mais c’est l’exemple parfait de ces petites remarques qui nous confrontent à la perception que notre famille a de nous.
Ce qu’il y a de particulièrement cruel, c’est que les membres de notre famille sont davantage les témoins d’un chemin parcouru que de notre identité à un moment t. Longtemps, ma famille m’a plutôt renvoyé une image de fille plutôt douée et bonne élève qui avait tout pour elle. Maintenant que je suis adulte et que je me lance sur un chemin risqué, pas très conventionnel, j’ai toujours peur de percevoir chez eux une once de déception. La comparaison avec des frères, des soeurs et des cousins ne facilite pas les choses. Il n’y a pas si longtemps, on faisait des cache-caches, on prenait nos bains tous ensemble et on portait les mêmes pulls-overs. Et voilà que soudain, aux yeux des parents, des oncles et des tantes, on réussit ou pas, on a une “bonne situation” ou pas. Et malgré le fait que je sois relativement indifférente à ces normes de réussites hors du cadre familial, leur jugement m’atteint.
Evidemment, les injonctions peuvent concerner un tas de sujets qu’évoquent Christelle Tissot et la thérapeute Laure Elizabeth Roussel dans le même épisode :
C’est le moment où tu es à table et où tu te demandes : à quel moment papi va me demander pourquoi j’ai pas encore de mec ? A quel moment on va me demander quand je vais faire un 2ème, un 3ème, un 4ème enfant ? A quel moment on va me demander si j’ai enfin retrouvé du travail ? A quel moment on va me dire “dis ce serait bien que t’arrêtes la bûche parce que tu as pris un peu de poids !” ?
Pour ma part, hormis le sujet professionnel où je me sens un peu ovni, la plupart des remarques m’amusent plus qu’autre chose. Le petit commentaire de ma tante sur le fait que j’ai encore minci, les regards désolés de ma mère sur une tenue un peu “schlag” - “faut pas se laisser-aller hein !”, les questions de ma grand-mère - “dis Loulou, tu as retrouvé un ami ?”, son envie d’arrière-petits-enfants très peu dissimulée - “j’aimerais bien que vous fassiez des petits bébés”, les scénarios qu’elle fait à haute voix à ce sujet - “Pierre il est très occupé. Toto et Jess, peut-être”. Bien sûr, je ne trouverais pas ces remarques aussi rigolotes si elles visaient des terrains de doute, de honte ou de décalage.
Des places figées
On se connaît depuis tellement longtemps, les bagages de souvenirs sont si lourds, on est parfois si peu à jour sur l’actualité de chacun qu’il peut exister un vrai décalage entre qui on est au quotidien et notre image en famille. On a l’impression de se connaître par coeur. On voit sa famille avec moins d’ouverture et de curiosité que lorsqu’on retrouve un ami, même si je ressens parfois cette inertie dans des groupes d’amis bien installés. N’étant prêt qu’à valider la perception que l’on a de l’autre, et sans doute un peu autocentré parce qu’on a envie de s’affirmer soi, on ne s’écoute pas.
Ce soir-là, on s’est demandé des nouvelles, souvent en abordant chacun sous l’angle habituel. “Alors Pierrot, apparemment vous avez gagné plein de concours ?”, “ça va mieux ton dos Gillou ?” Il y a quelques semaines, ma tante me présentait à ses copains en disant : “Alors Louise, elle a plein de talents, donc c’est compliqué de choisir !”. C’était plutôt gentil, mais ça m’a frustrée qu’on me présente encore comme une fille paumée. On a beau évoluer, changer d’avis, trouver sa place, se découvrir de nouvelles passions, explorer de nouvelles formes de relations, on reste un peu fichés, réduits aux mêmes traits de personnalité, aux mêmes situations professionnelles, aux mêmes comportements amoureux. C’est à se demander si en famille, on ne devient pas tous un peu des archétypes, comme ce cliché de l’“oncle réac” repris par tous les articles qui traitent des fêtes de famille. Il y a aussi la fille parfaite, celui à qui tout réussit professionnellement, la sensible un peu paumée, le glandeur, la petite dernière, la tante bohème, la tante bourgeoise…
Ces rôles dont chacun essayent en vain de s’échapper, on les retrouve dans le film La Bûche, sympathique conte de Noël à la française dans lequel trois filles et leur père s’apprêtent à se retrouver pour les fêtes. Il y a Louba, l’aînée, chanteuse bohème, marrante, tendre et excentrique, enceinte de son amant de toujours. Sonia, la bourgeoise, super job, mère de deux enfants parfaits, qui trompe son mari et son ennui avec un fleuriste. Et puis la benjamine, Milla, rebelle à fleur de peau qui déteste les fêtes de famille et enchaîne les fails amoureux. Toutes ont leurs soucis, toutes minimisent ceux des autres, toutes en ont marre de cette étiquette qui leur colle à la peau, toutes craquent à un moment ou à un autre du film.
Comme écrit joliment Claire Marin dans son essai Être à sa place :
Les témoins de ce passé me retiennent prisonnier dans cette place, la réaffirmant sans cesse comme ma véritable identité. Ils s’échinent à me rappeler qui j’étais, comme si ce passé m’obligeait à rester le même.
En famille, en plus, je peux avoir tendance à me dévaloriser et à projeter des jugements chez les uns et les autres. La pensée qu’on me pense encore “un peu perdue” suffit à me faire perdre l'assurance que j’acquiers par ailleurs. Résultat, je redeviens une fille hésitante, inhibée, silencieuse et policée. Comme écrit Claire Marin dans Rupture(s), j’ai ce sentiment que ma “véritable identité ne pourra pas éclore là, dans ces lieux, avec ces gens, dans ce réel-là qui m’étouffe”. Toujours dans le même épisode de la Zone Grise, Christelle Tissot et Laure Elisabeth Roussel évoquent ce sentiment que la famille fait l’effet d’une machine à remonter le temps.
L.E.R : En sortant de la cellule familiale, on peut s’affranchir de certains codes et de la place qu’on avait dans la famille et la fratrie. Désormais, on existe dans le monde avec d’autres étiquetages, d’autres manières d’être valorisé et de se valoriser soi-même. Et arrive le moment où tu reviens dans la famille et on te reprend pour “le petit qui doit se taire”.
C.T : Il peut y avoir un gros décalage entre notre vie quotidienne et ce moment de Noël qui est comme une machine à remonter le temps.
L.E.R : On te reparle de l’anecdote un peu honteuse, on continue à t’étiqueter selon des évènements qui sont arrivés quand tu avais 12, 13, 14 ans, on continue à te dire “mais toi, de toute façon, tu te met tout le temps en colère” “toi, tu ne t’es pas renseigné quand tu parles de quelque chose”… Certains de mes patients sont chefs d’entreprise et prennent la parole devant 2000 personnes sans aucune difficulté. Mais une fois chez eux, l’enfant en eux ressort et ils peuvent se sentent écrasés et très déstabilisés à table.
J’avais adoré Juste la fin du monde, un film de Xavier Dolan adapté de la pièce de Jean-Luc Lagarce. Louis, écrivain de 34 ans, rend visite à sa famille pour la première fois depuis des années avec l’intention de leur annoncer la maladie qui le condamne. Il retrouve ainsi sa mère, sa sœur, son frère et sa belle-sœur, mais son arrivée fait ressurgir des souvenirs, des rancoeurs et des tensions qui rendent la communication impossible. Dans cette interview, le réalisateur commente :
Ce qui m'intéressait dans la pièce, c’était de pouvoir explorer la place de chacun, les rapports des uns avec les autres, les manques, les attentes, les non-dits. Comme dans un repas de famille où l'on occupe toujours le même rôle, souvent très éloigné de notre véritable personnalité. Il ne s'agit guère d'être soi-même, mais plutôt de rester ce que les autres attendent de soi. (…)
Tout le monde en prend un peu pour son grade. La pièce de Lagarce parle de gens qui pensent s'aimer, se connaître, communiquer, mais qui ne savent pas s'écouter.
Pourquoi on s’inflige ça ?
Comme dit la chanson, “on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille”. On a un peu de sang en commun, un vague air de famille sur les photos, quelques anecdotes familiales qui n’amusent que nous. On a pas forcément ni les mêmes métiers, ni les mêmes opinions, ni les mêmes valeurs, ni le même âge, ni les mêmes centres d’intérêts. Et 2-3 fois par an, on doit “faire famille”.
Il y a quelque chose d’un peu absurde dans ce contrat social. En réalité, la famille ne va pas de soi. Ses frontières non plus : j’ai une cousine germaine que je n’ai pas vue depuis 8 ans. On a le choix de faire exister des liens familiaux ou pas, et cela jusqu’à une relation entre parents - enfant. C’est ce que raconte Constance Debré dans son puissant roman Love Me Tender : parce qu’elle a perdu la garde de son fils, parce qu’elle a été contrainte de s’en éloigner et qu’elle est devenue une étrangère pour lui, elle finit par “faire son deuil”. Elle écrit :
Je ne vois pas pourquoi l’amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les autres amours. Pourquoi on ne pourrait pas cesser de s’aimer. Pourquoi on ne pourrait pas rompre.
Comme le rappelle Marie Robert dans le super épisode de son podcast dédié à la famille :
La famille se définit juridiquement, pourtant elle est un mystère. Que sont pour nous nos parents, nos enfants, nos neveux, nos oncles, nos tantes, qu’est-ce qui nous lie avec ces individus ? Le sang, le devoir, l’amour, la reconnaissance, l’habitude ?
J’ai longtemps vu la famille comme une institution ringarde et conformiste, un engagement pesant, une injonction aliénante liée au seul hasard biologique, un “truc de cathos” très contraignant. Plus jeune, j’ai pensé que je n’étais “pas très famille” et j’ai fantasmé de me libérer du huis clos étouffant du “petit théâtre familial”, de m’affirmer en devenant “la pièce manquante du puzzle” (expressions tirées des essais de Claire Marin). Encore aujourd’hui, je garde un regard critique sur ma famille. Pendant les repas de fêtes, une petite partie de moi a toujours envie de fuir, comme Lous and the Yakuza dans sa chanson Dilemme : “si je pouvais je vivrais seule loin de mes chaînes et des gens que j'aime na-na-na-na”. Mais ça ne s’est traduit que par de petites escapades dans une chambre et de grandes inspirations dans une salle de bain.
Derrière ces envies de fuite un peu drama queen, il y a le sentiment que trouver sa place en famille est incompatible avec l’affirmation de soi. Dans Être à sa place, Claire Marin écrit :
A quel moment ai-je perdu ma voix ? Quelle main invisible s’est posée sur ma bouche ? Ma voix, sans même être interrompue ou recouverte par une autre, s’est faite de plus en plus silencieuse. J’ai renoncé à donner mon avis, à prendre la parole, à parler plus fort que les autres pour me faire entendre. Si nous étouffons nos voix, si nous les étourdissons, c’est dans l’espoir de faire partie de la grande chorale sociale. (…) On perd sa voix pour trouver une place, on abandonne un mode d’expression de soi dans l’espoir d’être entendue. Mais c’est en réalité à sa propre identité que l’on renonce.
Et même si mon niveau d’inauthenticité et son coût restent modérés en famille, je comprends ce dont parlait la professeur de yoga Lili Barbery dans une récente newsletter :
L'inauthenticité est très coûteuse sur les plans physique et émotionnel. Or, les fêtes de fin d’année marquent pour beaucoup l’apothéose des mascarades en tout genre. Faire semblant d’être heureux de voir des membres de notre famille qui projettent sur nous des attentes insatiables. Masquer nos fragilités pour éviter les jugements. Singer les réjouissances à table pour faire plaisir aux enfants malgré les drames qui se jouent en silence.
Dans le même épisode, Marie Robert résume la réflexion du philosophe Kierkergaard sur la famille. Ce dernier aurait identifié trois voies possibles, qui sont aussi pour lui trois stades de l’existence :
La première voie est le stade esthétique, celui de la recherche du plaisir et de l’épanouissement du désir. Pour congédier l’ennui, l’individu est affamé de nouveauté - comportement incarné par la figure de Dom Juan. Très loin de l’idée de vouloir fonder une famille, on est dans le refus de l’engagement. K. a d’ailleurs rompu net avec une jeune fille qu’il s’apprêtait à épouser. Ici, la famille fait l’effet d’une zone aliénante qui empêche de vivre et de penser.
Le second stade est le stade éthique, qui se se caractérise par le sentiment intense du devoir. Ici, il s’agit de revenir à la vie familiale, car pour K., la liberté n’est pas un choix complètement abstrait et délivré de tout contexte. Ici, il est peut-être question de nous réconcilier avec nos aïeux, d’assumer notre place dans la dynastie familiale, d’accepter les responsabilités, de mettre de la cohérence et de la continuité dans son existence.
Le dernier stade, c’est le stade religieux, celui du saut dans l’absurde, celui qui s’affranchit de l’éthique et des regrets. K fait le lien avec l’image d’Abraham dans l’ancien testament qui accepte de sacrifier Isaac au mépris de toute éthique. Ce dernier stade se tient donc au-delà de la famille : c’est un saut dans la foi qui demande d’abandonner ce qu’on tient pour acquis et nécessaire.
Aujourd’hui, je dois reconnaître que je suis plutôt “famille”. Ces dernières années, je suis peut-être passée du “stade esthétique” au “stade éthique”, moins par sens du devoir que parce que j’y trouve mon compte.
Pour moi, la famille est un rempart, un refuge, un pilier d’amour inconditionnel. Il n’y a que mes soeurs et ma mère devant qui je peux craquer et pleurer comme une madeleine, ce dont je ne me suis pas privée cet automne. Mes parents savent à quel point je peux être une teigne et ils m’invitent encore à déjeuner le dimanche, ce dont je leur suis reconnaissante. Quand tout me semble précaire, fragile et difficile, je trouve en famille un sentiment de sécurité, de stabilité et de continuité très rassurant. Aujourd’hui, je ne me serais sûrement pas lancée dans des projets professionnels aussi risqués et précaires 1) si mes parents ne m’avaient pas payé mes études, 2) si je n’avais pas eu une famille aimante et sécurisante.
J’aime aussi que les relations familiales ne dépendent pas d’atomes crochus et qu’elles nous confrontent à des opinions et des expériences de vie différentes. Tant que ça reste respectueux, il me semble qu’un peu de débat voire de conflit ne nous fait pas de mal. Comme l’écrit Heather Havrileski dans sa newsletter Ghosting is bad for you :
Avoidance of conflict prevents us from being exposed to different emotional experiences and opinions that might challenge our beliefs, expand our world views, and inspire us to grow in unforeseen ways. (…) The more we insist on so-called healthy, conflict-free relationships, the shallower and more transactional our relationships become, which leads to dissatisfaction and addictive behaviors. (…) Avoidance of conflict makes us more rigid in our beliefs and more isolated from each other.
J’aime ce que la famille me fait travailler : la patience, l’ouverture d’esprit, la curiosité, la solidarité, la compassion. Les fêtes de famille, dans tout ce qu’elles ont de gênant, d’absurde, de forcé et de laborieux, peuvent avoir quelque chose de drôle et joyeux - ceci dit, j’ai aussi la chance d’avoir des soeurs et des cousins avec qui rigoler.
Bref, je me reconnais tout à fait dans la conclusion de Marie Robert :
Après nous être libérés du destin familial, après nous être révoltés contre la famille, après l’avoir haïe, détestée, quittée, impossible de quitter ce podcast sans proposer d’y revenir. Par choix, par amour, avec des modalités qui nous conviennent et qui nous ressemblent.
Cela demande un travail considérable, des efforts, des discussions, des ajustements. Mais lorsqu’on y parvient enfin, la famille nous offre ce que le sociologue britannique Anthony Giddens appelle “une sécurité ontologique. C’est un lieu où l’on apprend la patience, l’altérité, le soutien et l’amour inconditionnel. Un espace où l’on a l’assurance que quelques soient les secousses du monde, il y aura toujours des parties de monopoly, des embrouilles de télécommande et la joie d’être ensemble.
Note à moi-même pour la Chandeleur
Sans tout accepter non plus, je crois qu’il faut surtout que je trouve une forme de distance émotionnelle vis-à-vis des opinions et des projections familiales, de façon à vivre tout ça avec plus de détachement et d’humour. Que j’accepte que ma famille ne comprendra jamais tout à fait mes choix et que j’arrête d’essayer de leur prouver quoi que ce soit. Leur incompréhension, leurs remarques à côté de la plaque et leur peur perceptible que je rate ma vie resteront un peu frustrantes, mais tout ça est secondaire à côté de l’amour et la solidarité inconditionnels qu’ils m’apportent. Et puis, comme le rappelle JK Rowling dans son célèbre Harvard Speech :
There is an expiry date on blaming your parents for steering you in the wrong direction; the moment you are old enough to take the wheel, responsibility lies with you.
D’ailleurs, dans l’épisode de Mūsae, la thérapeute Laure Elizabeth Roussel propose un exercice que je trouve intéressant pour dédramatiser injonctions et étiquetages.
Lorsqu’on arrive dans un lieu et qu’on a déjà une idée de l’étiquetage qu’on va recevoir, on peut se préparer une petite liste des 10 remarques désagréables que l’on pourrait se prendre et qui pourraient nous faire sortir de nos gonds. Si on en entends plus de 5 pendant la soirée, on peut se faire un cadeau. Résultat : là où d’habitude, on arrive sur la défensive en pensant “si ça tombe, ça va m’énerver”, cocher la case va générer une petite private joke avec soi-même.
Me mettre à leur place permet aussi de prendre les choses moins personnellement : si ma grand-mère me demande régulièrement si j’ai “rencontré quelqu’un”, c’est parce qu’à mon âge elle était mariée et mère de 2 enfants. Si ma mère me suggère des idées de “vrais métiers” à chaque fois que je la vois, hausse les sourcils quand je parle de mes projets et me fait des remarques parfois un peu blessantes, c’est sans doute qu’elle a très peur que je reproduise les erreurs qu’elle juge avoir faites, que je me plante et que j’ai une vie très difficile. Il s’agit là de “la voix du parent, la voix blanche de la peur qui fait saisir intuitivement à l’enfant les limites assignées” (Être à sa place, Claire Marin).
Et pour briser la glace, créer des relations plus honnêtes, sympas et authentiques avec avec sa famille élargie, il est sûrement utile de poser des questions sincères même lorsque ça détonne avec le small talk ambiant, de faire des pas vers les autres, d’avoir des petites attentions, d’être à l’écoute et d’accepter de se laisser surprendre par les gens… Au dîner du réveillon, un cousin m’a posé des vraies questions sur mes projets et sa curiosité m’a vraiment touchée. Dire un peu ce qu’on pense, aussi. Il y a quelques semaines, dans un débat sur le Whatsapp familial d’habitude très consensuel, ma petite soeur a tenu tête à mon cousin dont un message sonnait un peu condescendant. Son franc-parler et sa ténacité nous ont tous un peu surpris, mais c’était rafraîchissant. L’autre jour, ce même cousin se confiait pour la première fois sur le fait qu’il ne se voyait pas travailler dans un bureau toute sa vie, et ça faisait du bien de se dire des vrais trucs. Comme l’écrit encore Heather Havrileski :
Honest, intimate relationships aren’t easy. That’s part of the reason we learn so much from them, and grow so much from returning to them at times when our most fearful, defensive selves would prefer to isolate in a dark cave where we’re always right instead. (…) Keeping your heart open takes hard work, particularly when so many messages from the outside world treat independence, indifference, and dogmatic allegiance as the triumphant realm of life’s true winners.
D’ailleurs, si vous cherchez des conseils pour “survivre” aux fêtes de famille, je vous conseille de lire son super article Holiday Survival Guide. En conclusion, elle écrit :
Families require a lot of forgiveness. It’s not easy. And sometimes it’s not possible at all. Be gentle with yourself, no matter what your circumstances might be during the holidays. Respect your limits. Resist the urge to dive into conversations when you’re agitated. Take a deep breath, have another piece of pie, do the dishes. Remember that every family is taxing in its own special way. Try to enjoy the peculiarities, foibles, and absurdities of your own terrible clan as much as you possibly can. And if you can’t? Eat more pie.
Au réveillon, même casting sans les cousins. On est allé à la messe de Saint-Eustache et comme d’habitude, on est arrivés 25 minutes en retard, on s’est tous un peu dispersés et chacun s’est fait sa petite balade dans l’église. Je ne suis ni pratiquante ni croyante, mais j’aime bien les messes : l’épaisseur des murs et la hauteur des voûtes qui font se sentir tout petit, le joyeux mélange des générations, les jolis chants et les silences, les odeurs d’encens… Tout ça m’est familier, m’apaise et me remplit d’une joyeuse nostalgie. A la fin, je suis restée écouter l’orgue déchaîné avec mon père - “imagine ça au Moyen-Âge, éclairé à la bougie et tout !” De la soirée chez ma tante qui a suivi, je ne me souviens que du menu : tartines de saumon, gougères au fromage, poularde, éternel macaron aux framboises de chez Picard. Et d’un repas de Noël typique, sans étincelles, chaleureux et réconfortant.
C’est la fin de cette newsletter. J’espère qu’elle vous a plu !! Comme d’habitude, n’hésitez pas à me répondre ou à commenter ce post pour me partager votre ressenti. Vous lire me fait toujours super plaisir. Et bien sûr, n’hésitez pas à partager cette newsletter et/ou à vous y abonner.
Enfin, si vous aimez mon travail, n’hésitez pas à me faire un petit don pour me soutenir. Vous pouvez me laisser 1, 2,…, 1 000 000 € sur cette cagnotte. Une super façon de m’aider si vous adorez cette newsletter ? Me faire un don régulier, par exemple de 1 ou 2 € par mois. Un immense merci à celles et ceux qui feront un petit geste et m’enverront un shoot de motivation par la même occasion ! ❤️
Je vous laisse méditer sur ce passage d’Une Chambre à Soi 😉
La très grande activité intellectuelle que manifestèrent les femmes dans la dernière partie du XVIIIe siècle - causeries, réunions, essais sur Shakespeare, traductions des classiques - était justifiée par le fait indiscutable qu'elles pouvaient gagner de l'argent en écrivant.
Voilà, c’est vraiment fini pour aujourd’hui !!
Encore merci à mes soeurs pour leur relecture et leur vigilance - “elle est pas trop méchante en vrai” ; “Rien de vexant je pense”.
A bientôt !
Louise





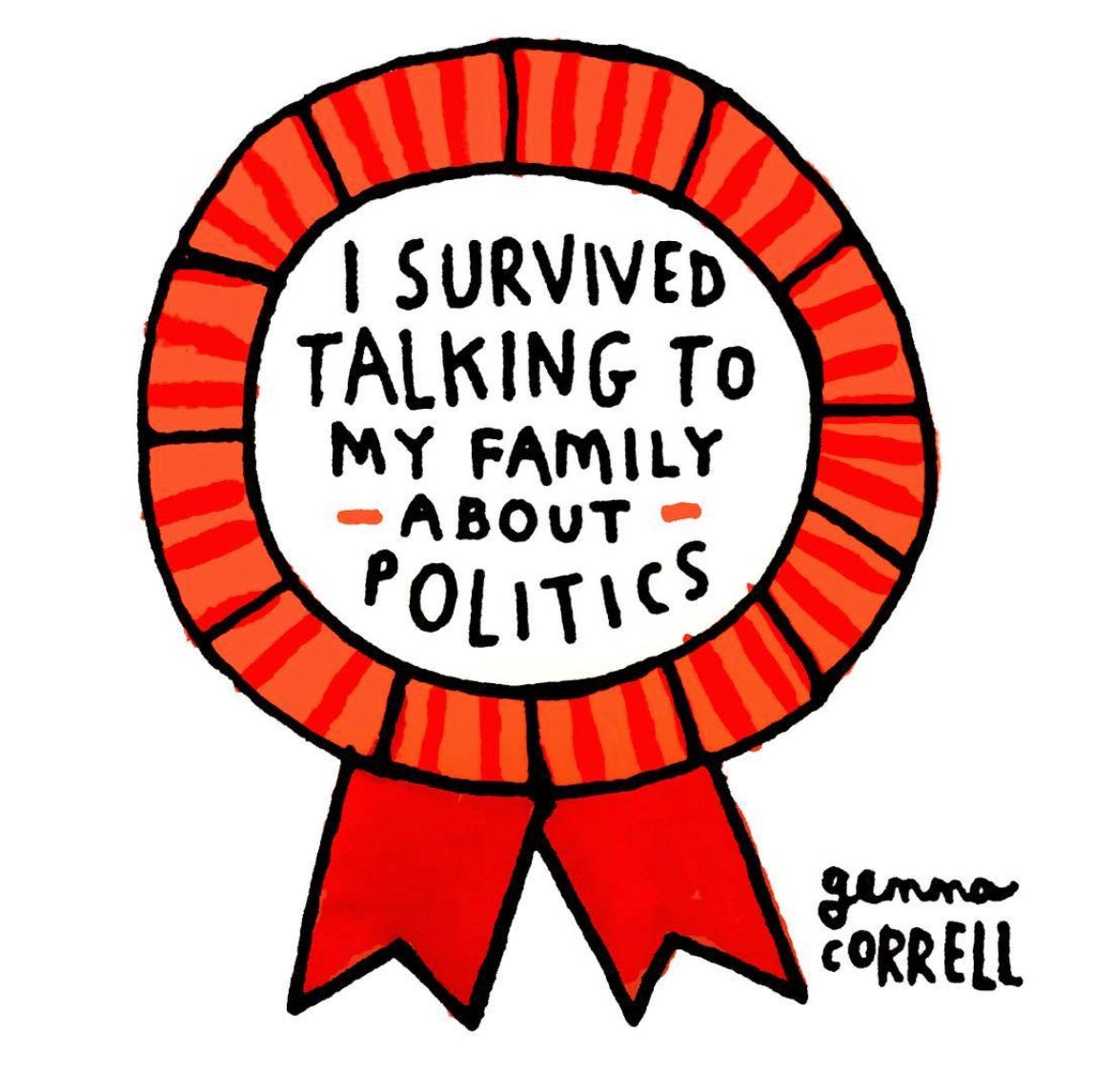





Encore un plaisir de te lire!
Pertinent et riche de plein de réflexions 🙏
Transférée à 2 personnes.
Merci !